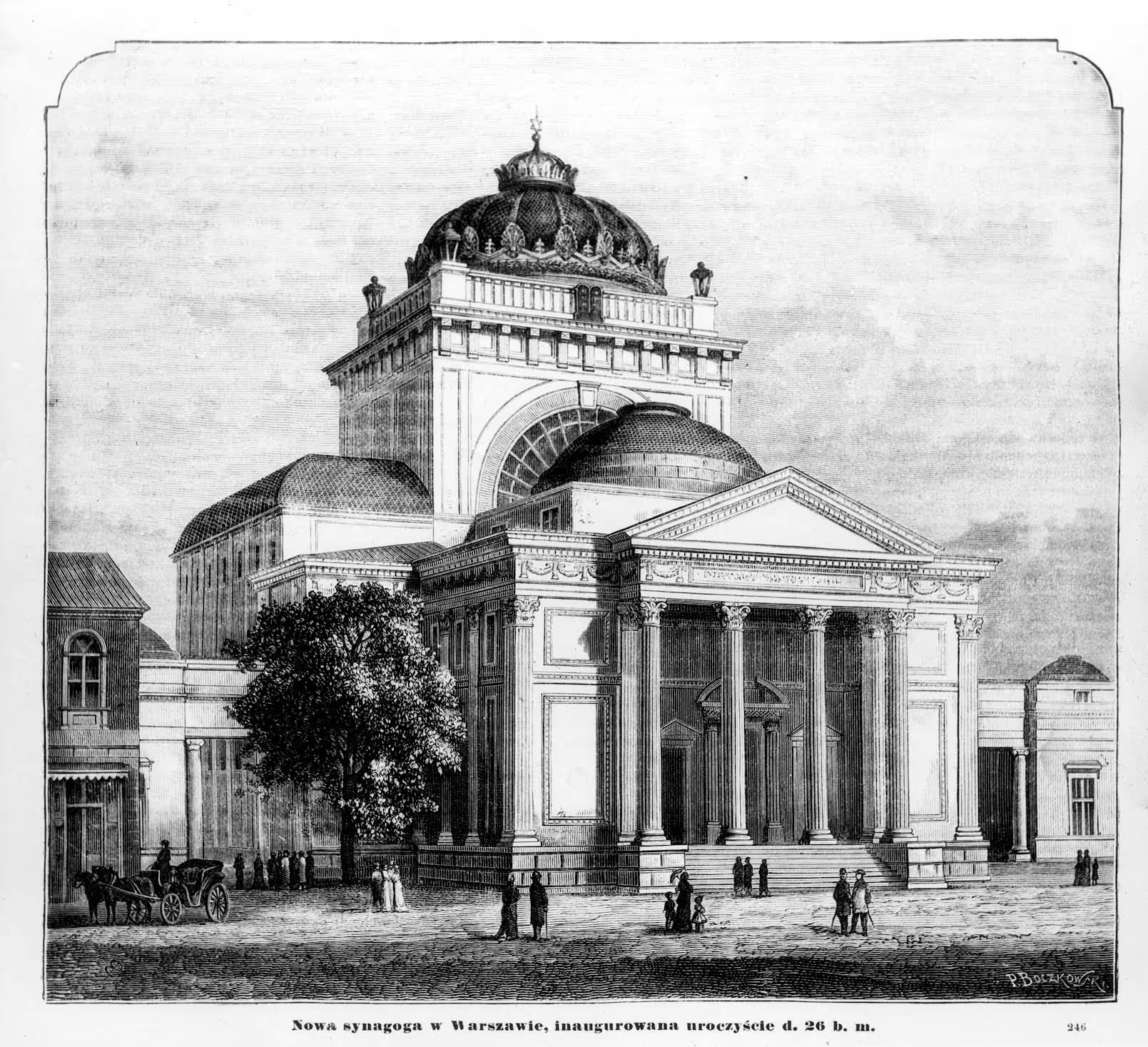Survie économique
Un fermier juif labourant un champ. (Lieu, date inconnus.)

Comme la majorité des Juifs des villages étaient pauvres et que peu de professions offraient la stabilité économique, la plupart des Juifs exerçaient plus d'une profession et devaient être qualifiés dans plusieurs domaines d'activité. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une telle existence rurale, seule une petite minorité de Juifs étaient agriculteurs. Cela s'explique notamment par le fait que peu de Juifs possédaient de grandes parcelles de terre ; plus important encore, le rôle de fermier était le territoire de longue date de la paysannerie non juive. Néanmoins, la plupart des Juifs des villages jardinaient et cultivaient certains aliments, notamment des concombres et des fruits, dans leurs propres jardins ou sur de petites parcelles appartenant à des voisins.
Historiquement, l'une des occupations juives les plus courantes était celle de Arendar (directeur du domaine) pour la noblesse qui possédait la plus grande partie des terres rurales. Les Juifs payaient leur loyer à l'avance et étaient chargés de la difficile tâche de gérer la terre et de commercialiser ses biens et ses produits. D'autres Juifs étaient employés par des propriétaires fonciers pour gérer les vergers ou les moulins à céréales des domaines. Les meuniers juifs, en particulier, étaient des intermédiaires prospères qui pouvaient gagner une vie assez décente en moulant le grain des paysans et en conservant les restes de farine pour eux-mêmes en paiement de ce service.

Chaque village comptait des commerçants, un tailleur ou deux, des forgerons, des cordonniers et d'autres artisans, tandis que des charpentiers, des charrons et d'autres personnes venaient régulièrement offrir leurs services aux villageois. Comme les paysans et les Juifs n'avaient souvent pas de devises fortes pour le paiement, des arrangements commerciaux complexes ont été mis au point pour le paiement, tels que le troc de pommes de terre, de céréales et de légumes contre des services, ou la possibilité pour les commerçants de cultiver de petites parcelles sur les terres des paysans pour leur propre usage. La concurrence étant féroce, les colporteurs ont dû maintenir leurs prix bas, ce qui les maintient dans une pauvreté perpétuelle. Ils ont parcouru le pays à pied ou en chariot, séjournant chez des familles paysannes et juives pendant la semaine et subissant très peu de revenus. Le sabbat était la lumière dont il avait tant besoin à la fin de la semaine, lorsque le colporteur est rentré chez lui, peut-être avec une poule, des œufs et des légumes à préparer pour sa femme.

Chaque dorf avait également un ou deux chauffeurs juifs qui transportaient des marchandises entre les villes et les villages pour les familles, les commerçants et d'autres entreprises avant que le chemin de fer n'atteigne les zones reculées de la campagne. Leurs chariots tirés par des chevaux remplissaient les routes de campagne, surtout avant Shabbat et les jours de marché. Souvent, leurs chariots étaient trop pleins de marchandises pour que les conducteurs puissent s'asseoir ; au lieu de cela, ils marchaient à côté de leurs chevaux pendant des kilomètres, en tenant les rênes à la main.
D'habitude, l'aubergiste juif offrait également une oasis le long des routes de campagne désertes. L'auberge servait d'aire de repos, d'hôtel et de taverne servant du whisky, de la bière et (souvent) des plats chauds. Il a servi de magasin fournissant des réparations et de nouvelles pièces aux wagons en détresse, tout en fonctionnant comme un lieu de divertissement pour les voyageurs et les paysans locaux avec peu de divertissements à leur disposition. L'aubergiste était presque toujours juif et était une figure particulièrement mythologique de la littérature et du théâtre polonais du XIXe siècle. Il a servi d'intermédiaire entre les propriétaires et les habitants, de proto-capitaliste reliant le pays à la ville, et il a apporté un peu du monde extérieur aux paysans. Pour cela, l'aubergiste était à la fois admiré et irrité. Dans certains romans polonais, l'aubergiste était décrit comme un boiteux ou à moitié aveugle, un escroc sophistiqué et à deux visages qui escroquait leur argent aux malheureux paysans polonais. L'aubergiste a également été décrit comme le gardien d'un monde souterrain étrange et inconnu (les tavernes auraient des passages et des pièces secrets) à la lisière de forêts sombres et effrayantes. Parmi les nombreux non-juifs qui accusaient les aubergistes juifs d'être responsables de l'ivresse des paysans, un problème chronique considéré comme étant à l'origine de leur malaise général et de leur pauvreté était très répandu.