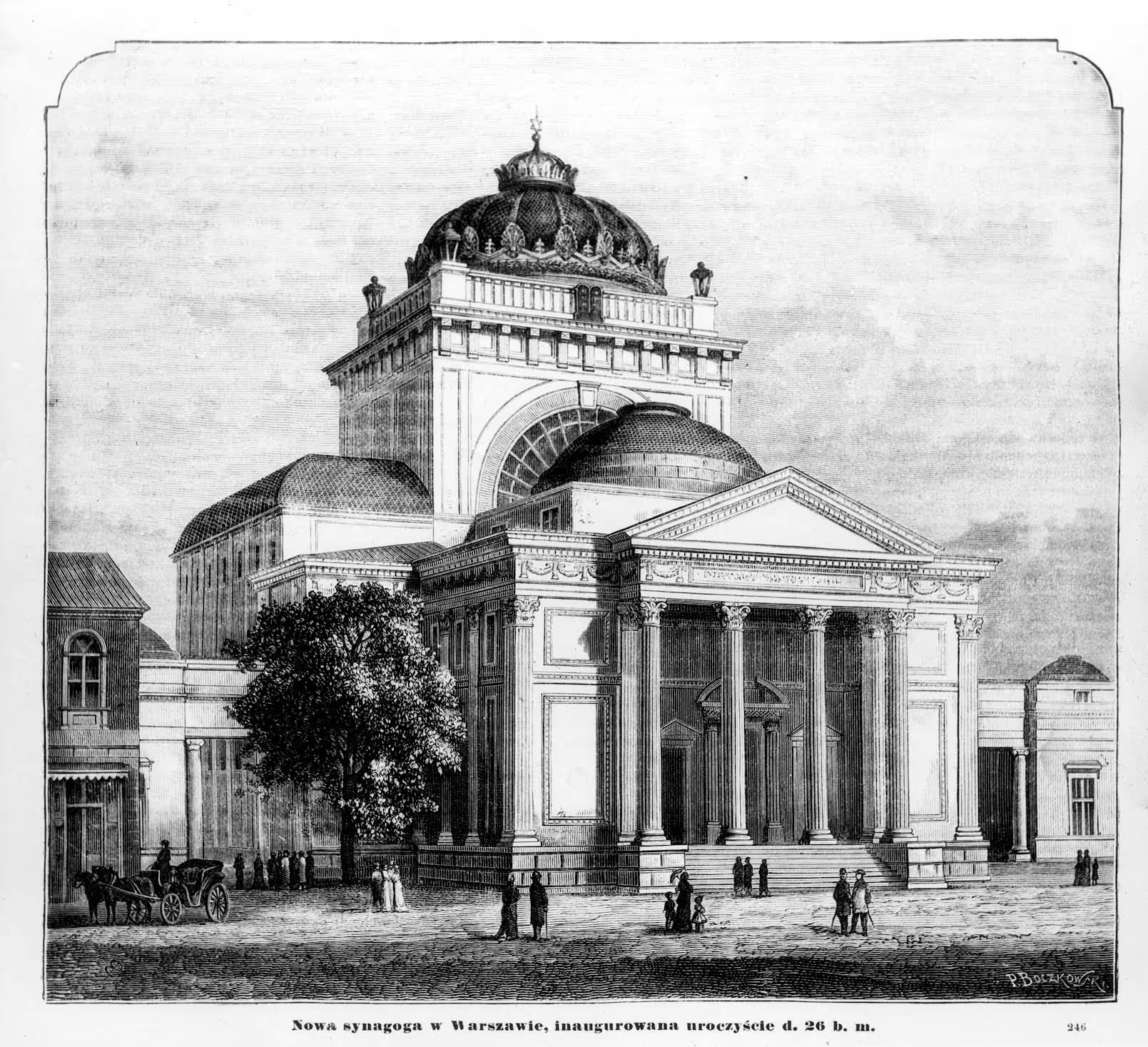Derfer
Quitter ma famille - Toby Knobel Fluek


Un rôle bien moins central pour la communauté juive ashkénaze a été joué par dorf (petit village) avec des familles juives dispersées dont le nombre était trop faible pour tenir compte de la diversité culturelle et qui faisaient défaut dans les institutions et services juifs qui existaient dans la ville et shtetl. Dans ces différer Les Juifs formaient des groupes de quelques dizaines de familles, vivant au sein de majorités chrétiennes pour lesquelles les Juifs remplissaient souvent les rôles économiques nécessaires. Sans la force qui découlait de leur propre nombre, une sorte de sécurité leur assurait une sorte de sécurité urbaine et shtetl Les Juifs sont les fruits de la vitalité communautaire, différer étaient isolés et culturellement appauvris. Une telle famille aurait-elle dû avoir besoin d'un kheyder pour leurs enfants ou toute autre forme de vie juive organisée, il était probable qu'ils aient à se rendre dans la grande communauté juive la plus proche pour ce service vital.

Même pour célébrer les grandes fêtes, les familles devaient souvent se rendre dans une ville voisine. Le plus souvent un dorf avait au moins mélamé (enseignant), ou quelqu'un qui pourrait enseigner le Alef-beys (ABC) à de jeunes enfants, ainsi qu'une synagogue improvisée dans la maison d'un membre distingué de la communauté où les Juifs pouvaient prier. Juifs dans ces différer ont essayé très consciemment de maintenir leur « distance » par rapport aux paysans qui les entouraient malgré leurs interactions quotidiennes les uns avec les autres. Les Juifs ont essayé de nombreuses manières de se différencier de la population locale, que ce soit en essayant de porter des chaussures pour marquer une différence physique ou en utilisant d'autres indicateurs de leur culture et de leur niveau d'éducation. Ces Juifs des zones rurales qui, pour la plupart, entretenaient des relations amicales avec leurs voisins, s'efforçaient de préserver leur identité juive ; ils ne voulaient pas que les Juifs des villes les considèrent comme des paysans. C'était un statut marginal qu'ils ont essayé de rejeter.
Derfer

La vaste campagne de l'Europe de l'Est d'avant la Seconde Guerre mondiale était parsemée de milliers de villages et de hameaux, appelés différer en yiddish, dont beaucoup comptaient de petites communautés juives. Ces communautés juives vivaient dans un isolement relatif, souvent en marge d'une communauté non juive plus importante. De plus, comme les Juifs des villages constituaient une partie relativement peu instruite et pauvre de la population juive, les Juifs urbains et instruits avaient tendance à les considérer comme des cousins rustiques de la campagne. Ces Juifs du village ont néanmoins joué des rôles économiques indispensables, et souvent uniquement juifs, en tant qu'intermédiaires et ouvriers qualifiés au sein de sociétés essentiellement agraires, sociétés dans lesquelles la plupart des non-Juifs ruraux restaient attachés à la vie agricole séculaire que leurs familles avaient transmise au fil des siècles. Ce n'est qu'à l'aube de l'industrialisation et des bouleversements du XXe siècle que les paysans non juifs ont commencé à concurrencer et, plus tard, à remplacer les Juifs en tant que marchands et artisans.

Le principal défi pour différer Les Juifs qui vivaient sans ces institutions, familières aux grandes communautés juives, devaient savoir comment accomplir leurs devoirs communautaires, culturels et religieux de base : prier dans un minyan (souvent des hommes), aller à la synagogue, envoyer des enfants dans des écoles juives, enterrer des membres de leur famille et, en fait, comment rester juifs. La plupart des villages n'avaient ni synagogue ni rabbin, et c'était aux laïcs de diriger les prières et de former minyanim. Pour célébrer les fêtes, se procurer de la viande casher et observer les rites juifs de base, il fallait souvent se rendre en ville, un voyage rarement possible pour la majorité des Juifs du village.

Survivre en tant que Juifs dans un tel isolement était un équilibre délicat ; d'une part, dépendre de la majorité non juive pour la plupart des besoins économiques et quotidiens et, d'autre part, préserver une insularité particulière parmi les quelques Juifs présents. Cette existence distincte, qui avait survécu pendant des siècles tout au long de la différer de l'Europe de l'Est, a entamé un net déclin à la fin du XIXe siècle alors que la modernité s'emparait et que les nouveaux gouvernements nationalistes et antisémites ont créé des obstacles majeurs à la vie juive. Sur les terres russes, les Juifs ne pouvaient rester dans leurs villages qu'en soudoyant les autorités tsaristes. La Première Guerre mondiale n'a fait qu'accroître la pauvreté et la souffrance, et de nombreux Juifs des zones rurales restants ont été épuisés ou expulsés par leurs voisins. Dans les villages lituaniens et polonais, les choses n'allaient pas mieux. Dans les années 1930, les gouvernements ont attisé les craintes des paysans en désignant les Juifs comme boucs émissaires, tout en subventionnant le développement économique qui a poussé les Juifs à abandonner leur métier.
דערפֿער
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. .. . .. . ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ;. . ((()))). . (), (,),,,,,,,,,,,,,. .